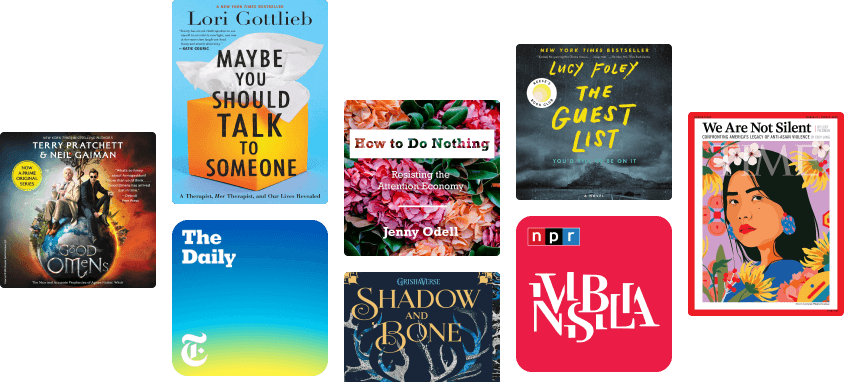Contes et nouvelles: Tome V
Par Léon Tolstoï
()
À propos de ce livre électronique
20 ans ont passé. Le fils du comte, de passage dans cette même ville, est logé chez Anna Fédorovna, la veuve jadis séduite. Lisa, sa fille, attend avec impatience la venue de ce jeune hussard qui va adopter les mêmes comportements que son père.
Tolstoï, qui a participé à la guerre du Caucase, porte un regard amusé et ironique sur les hussards dont le monde tourne autour de la guerre, de la boisson, du jeu et des femmes.
Léon Tolstoï
Nació en 1828, en Yásnaia Poliana, en la región de Tula, de una familia aristócrata. En 1844 empezó Derecho y Lenguas Orientales en la universidad de Kazán, pero dejó los estudios y llevó una vida algo disipada en Moscú y San Petersburgo. En 1851 se enroló con su hermano mayor en un regimiento de artillería en el Cáucaso. En 1852 publicó Infancia, el primero de los textos autobiográficos que, seguido de Adolescencia (1854) y Juventud (1857), le hicieron famoso, así como sus recuerdos de la guerra de Crimea, de corte realista y antibelicista, Relatos de Sevastópol (1855-1856; ALBA CLÁSICA núm. CXXVIII). La fama, sin embargo, le disgustó y, después de un viaje por Europa en 1857, decidió instalarse en Yásnaia Poliana, donde fundó una escuela para hijos de campesinos. El éxito de su monumental novela Guerra y paz (1865-1869) y de Anna Karénina (1873-1878; ALBA CLÁSICA MAIOR núm. XLVII; ALBA MINUS núm. 31), dos hitos de la literatura universal, no alivió una profunda crisis espiritual, de la que dio cuenta en Mi confesión (1878-1882), donde prácticamente abjuró del arte literario y propugnó un modo de vida basado en el Evangelio, la castidad, el trabajo manual y la renuncia a la violencia. A partir de entonces el grueso de su obra lo compondrían fábulas y cuentos de orientación popular, tratados morales, ensayos como Qué es el arte (1898) y algunas obras de teatro como El poder de las tinieblas (1886) y El cadáver viviente (1900); su única novela de esa época fue Resurrección (1899), escrita para recaudar fondos para la secta pacifista de los dujobori (guerreros del alma). Una extensa colección de sus Relatos ha sido publicada en esta misma editorial (ALBA CLÁSICA MAIOR núm. XXXIII; ALBA MINUS núm. 79). En 1901 fue excomulgado por la Iglesia ortodoxa. Murió en 1910 en la estación de tren de Astápovo.
En savoir plus sur Léon Tolstoï
Guerre et Paix (Edition intégrale: les 3 volumes) Évaluation : 5 sur 5 étoiles5/5Raison, Foi, Prière Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationQu'est-ce que l'art ? Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluation
Lié à Contes et nouvelles
Livres électroniques liés
Deux Hussards Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationRocambole - Le Club des Valets-de-coeur: Tome II - Les Drames de Paris - 1re série Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationLe Club des Valets-de-Coeur II Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationLe Club des Valets-de-Coeur Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationJacquot sans oreilles Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationLa San-Felice, Tome 05 Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationLes Âmes mortes: Tome II Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationRocambole - Les Misères de Londres: Tome IV - Les Tribulations de Skoking Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationLa femme immortelle Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationLes Exploits de Rocambole II Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationLes Exploits de Rocambole - Tome III - La Revanche de Baccarat Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationLes Chevaliers du Clair de Lune I Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationBonne-Marie Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationHistoires à dormir debout Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationLes Bourgeois de Garocelle Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationLes misères de Londres 4. Les tribulations de Shoking Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationIl Viccolo di Madama Lucrezia Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationDisparu !: La Tresse blonde Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationLa Femme immortelle Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationLe Vicomte de Bragelonne - Tome I Évaluation : 4 sur 5 étoiles4/5Rocambole - En prison Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationLa Comtesse de Saint-Géran Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationL'inconnue à la robe rouge Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationStymphalides: Une enquête dans le Lyon de la Belle Epoque Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationLe Maître d'armes Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationLe crime de Sylvestre Bonnard Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationLes amours du temps passé Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationLe Mystère du B 14 Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationLe Collier de la Reine - Tome I - (Les Mémoires d'un médecin) Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationMademoiselle Clocque Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluation
Fiction littéraire pour vous
Crime et châtiment Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationOrgueil et Préjugés - Edition illustrée: Pride and Prejudice Évaluation : 4 sur 5 étoiles4/5Le Rouge et le Noir Évaluation : 4 sur 5 étoiles4/5Bel-Ami Évaluation : 4 sur 5 étoiles4/5L'alchimiste de Paulo Coelho (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvre Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationDu côté de chez Swann Évaluation : 4 sur 5 étoiles4/5Mauvaises Pensées et autres Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationL'Étranger d'Albert Camus (Analyse de l'œuvre): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvre Évaluation : 3 sur 5 étoiles3/5Crime et Châtiment Évaluation : 5 sur 5 étoiles5/5Les Freres Karamazov Évaluation : 2 sur 5 étoiles2/5Sous le soleil de Satan (Premium Ebook) Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationL'Alchimiste de Paulo Coelho (Analyse de l'oeuvre): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvre Évaluation : 4 sur 5 étoiles4/5La Peur Évaluation : 5 sur 5 étoiles5/5La Vie devant soi de Romain Gary (Fiche de lecture): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvre Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationMadame Bovary Évaluation : 4 sur 5 étoiles4/5Bonjour tristesse de Françoise Sagan (Analyse de l'oeuvre): Comprendre la littérature avec lePetitLittéraire.fr Évaluation : 5 sur 5 étoiles5/5Germinal Évaluation : 5 sur 5 étoiles5/5Orgueil et Préjugés (Edition bilingue: français-anglais) Évaluation : 4 sur 5 étoiles4/5Les Hauts de Hurle-vent Évaluation : 4 sur 5 étoiles4/5Histoires érotiques gay: Nouvelles GAY érotiques français, non censuré hommes Évaluation : 1 sur 5 étoiles1/5Vernon Subutex, tome 1 de Virginie Despentes (Analyse de l'oeuvre): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvre Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationL'expulsion d'Adam et Eve du Ciel Selon Le Diable Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationLa Peste d'Albert Camus (Analyse de l'oeuvre): Comprendre la littérature avec lePetitLittéraire.fr Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationLe Dernier Jour d'un condamné Évaluation : 4 sur 5 étoiles4/5Illusions perdues Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationHarry Potter à l'école des sorciers de J. K. Rowling (Fiche de lecture): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvre Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationLe Temps retrouvé Évaluation : 5 sur 5 étoiles5/5L'oeil du loup: Analyse complète de l'oeuvre Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationQuand l'Afrique s'éveille entre le marteau et l'enclume: Roman Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationJournal d'un pervers narcissique Évaluation : 5 sur 5 étoiles5/5
Avis sur Contes et nouvelles
0 notation0 avis
Aperçu du livre
Contes et nouvelles - Léon Tolstoï
Contes et nouvelles
Contes et nouvelles
DEUX HUSSARDS
HADJI MOURAD
Page de copyright
Contes et nouvelles
Léon Tolstoï
DEUX HUSSARDS
« … Jomini et Jomini.
Et pas un mot sur l’eau-de-vie. »
D. DAVIDOV.
Dans les années 1800, au temps où il n’y avait encore ni chemins de fer, ni chaussées, ni éclairage au gaz, ni bougies stéariques, ni divans bas à ressorts, ni meubles sans vernis, ni jeunes gens désillusionnés, porteurs de monocles, ni femmes libérales, philosophes, ni charmantes Dames aux Camélias comme il s’en trouve tant de nos jours – dans ce temps naïf, où l’on allait de Moscou à Pétersbourg, en chariot ou en voiture, emportant avec soi une cuisine entière de provisions, où l’on roulait pendant huit jours sur des chemins défoncés, poussiéreux ou boueux, où l’on faisait confiance aux côtelettes Pojarski, aux sonnettes de Valdaï[1] et aux boulblikï[2] – où, durant les longues soirées d’automne brûlaient des chandelles de suif éclairant le cercle familial de vingt ou trente personnes ; où, au bal, on mettait dans les candélabres des bougies de cire ou de spermaceti, où l’on disposait les meubles symétriquement, où nos pères étaient encore jeunes non seulement parce qu’ils n’avaient ni rides ni cheveux blancs, mais parce qu’ils se battaient au pistolet pour une femme et se précipitaient d’un bout à l’autre d’un salon pour ramasser un mouchoir tombé à terre par hasard ou non ; où nos mères portaient des tailles courtes et d’énormes manches et décidaient les affaires de famille à la courte paille, où les charmantes Dames aux Camélias se cachaient de la lumière du jour – au temps naïf des loges maçonniques, des martinistes, des tougenbund, au temps des Miloradovitch, des Davidov, des Pouchkine, dans le chef-lieu K***, se tenait l’assemblée des seigneurs ruraux et les élections des représentants de la noblesse touchaient à leur fin.
« Eh bien ! Qu’importe, même à la salle commune si vous voulez, dit un jeune officier enveloppé d’une pelisse, coiffé du casque de hussard, et qui arrivait directement en traîneau de voyage dans le meilleur hôtel de la ville de K***.
– Ah, mais il y a tellement de monde, mon petit père Votre Excellence », déclarait le portier qui avait déjà réussi à savoir, par le brosseur, que le hussard s’appelait comte Tourbine, et pour cela lui donnait du « Votre Excellence ». « La dame d’Afremov, avec ses filles, a promis de partir ce soir, alors quand la chambre n° 11 sera libre, vous pourrez l’occuper », ajouta-t-il en précédant le comte dans le couloir tout en se tournant vers lui sans cesse.
Dans la salle commune, devant la petite table, près du portrait en pied, très enfumé, de l’empereur Alexandre Ier, quelques messieurs, probablement des nobles du pays, étaient assis devant du champagne, avec, à côté d’eux, des marchands ou des voyageurs en pelisses bleues.
Le comte, en entrant dans la pièce, appela Blücher, un énorme chien mâtin gris qu’il avait avec lui, ôta son manteau dont le collet était couvert de givre, et commanda de l’eau-de-vie. Resté dans son arkhalouk[3] de soie bleue, il prit place à table et entama la conversation avec les messieurs présents qui, gagnés tout de suite par la physionomie belle et ouverte du voyageur, lui proposèrent une coupe de champagne. Le comte but d’abord un petit verre d’eau-de-vie, puis commanda aussi une bouteille pour régaler ses nouvelles connaissances. Le postillon se présenta pour réclamer un pourboire.
« Sachka ! cria le comte, donne-le-lui ! »
Le postillon sortit en compagnie de Sachka, et revint bientôt avec l’argent dans la main.
« Eh quoi ! mon petit père, Votre Excellence ! Il me semble pourtant avoir peiné pour Ta Grâce ! Tu m’as promis cinquante kopecks et il ne m’en donne que vingt-cinq.
– Sachka ! Donne-lui un rouble. »
Sachka, les yeux baissés, fixait les pieds du postillon.
« C’est assez pour lui, dit-il à voix basse, et du reste je n’ai plus d’argent. »
Le comte tira de son portefeuille les deux seuls billets bleus qui s’y trouvaient, et en remit un au postillon qui lui baisa la main et sortit.
« Ça y est ! Je suis fini, dit le comte, ce sont mes derniers cinq roubles.
– C’est à la hussarde, comte ! fit en souriant un des gentilshommes, évidemment un cavalier en retraite, à en juger par la moustache, la voix et l’allure énergique des jambes. Vous avez l’intention de rester longtemps ici, comte ?
– Il me faut trouver de l’argent, autrement je ne resterai pas. D’ailleurs, il n’y a pas de chambre, que le diable les emporte dans cette maudite auberge…
– Permettez, comte, s’écria le cavalier, pourquoi ne pas vous installer ici ? J’occupe le n° 7. Si vous voulez me faire l’honneur de passer la nuit chez moi, en attendant. Restez chez nous trois jours. Aujourd’hui il y a bal chez le chef de la noblesse. Comme il serait heureux !
– Oui, oui, comte, restez donc, ajouta un autre des interlocuteurs, un joli jeune homme, pourquoi partir si vite ? Les élections n’ont lieu qu’une fois en trois ans. Vous verrez au moins nos belles demoiselles.
– Sachka ! Ramène du linge, je vais aller au bain, dit le comte en se levant. Après nous verrons, peut-être en effet irai-je chez le chef de la noblesse. »
Il appela ensuite le garçon pour lui dire deux mots, auxquels le garçon répondit en souriant : « Que tout se fait par les mains de l’homme », et sortit.
« Alors, mon cher, je fais transporter ma valise dans votre chambre, cria le comte sur le pas de la porte.
– S’il vous plaît, j’en serai heureux, répondit le cavalier en accourant vers lui. N’oubliez pas, n° 7. »
Le comte s’éloigna et le cavalier retourna à sa place. Il s’assit très près d’un fonctionnaire et, le regardant en face, l’œil souriant, il dit :
« Mais c’est lui en personne !
– Hein ?
– Je te dis que c’est ce même hussard, ce bretteur, en un mot Tourbine : il est très célèbre. Je te parie qu’il m’a reconnu. Et comment donc ! À Lébédiane, quand j’étais dans la remonte, nous avons fait la noce ensemble trois semaines sans interruption. Là-bas, nous en avons fait tous les deux, ah ! ah ! Un sacré gaillard, hein ?
– Un vrai ! Et comme il est d’abord agréable ! On n’a jamais rien vu de pareil, répondit le joli jeune homme. Comme on a eu vite fait de lier connaissance… Quoi ! il a vingt-cinq ans, pas davantage ?
– Non, il paraît cet âge, mais il a plus. Ah ! il faut savoir qui c’est ! Qui a enlevé Mme Migounova ? Lui. C’est lui qui a tué Sabline. C’est lui qui, prenant Matnev par les jambes, l’a lancé par une fenêtre. C’est lui qui a gagné trois cent mille roubles au prince Nestérov. Il faut connaître cette tête brûlée : joueur, bretteur, séducteur, mais hussard dans l’âme ; un vrai hussard. Il n’y a que des racontars sur nous, ah, si l’on comprenait vraiment ce qu’est un vrai hussard ! Ah ! c’était le bon temps ! »
Et le cavalier se mit à narrer à son interlocuteur une fabuleuse orgie à Lébédiane avec le comte, qui non seulement n’avait jamais eu lieu, mais qui ne pouvait avoir eu lieu. Premièrement, parce qu’il n’avait jamais encore vu Tourbine, ayant pris sa retraite deux ans avant que le comte n’entrât au service, et deuxièmement, parce qu’il n’avait pas servi dans la cavalerie, mais avait été, pendant quatre ans, un modeste junker du régiment de Bielevsk et avait pris sa retraite aussitôt que promu lieutenant. Mais, dix années auparavant, ayant reçu un héritage, il était allé effectivement à Lébédiane, avait dépensé là, avec les remonteurs, sept cents roubles et s’était fait faire un uniforme à parements orange, afin d’entrer aux uhlans. Le désir d’entrer dans la cavalerie, et les trois semaines passées avec les remonteurs à Lébédiane, restaient la période la plus brillante et la plus heureuse de sa vie, si bien que ce désir, pris d’abord pour la réalité, était devenu ensuite très vite un souvenir véritable. Il commençait lui-même déjà à croire fermement en son passé de cavalier, ce qui du reste ne l’empêchait pas d’être, par sa douceur et son honnêteté, l’homme le plus estimable.
« Oui, qui n’a pas servi dans la cavalerie ne comprendra jamais notre camarade ! » Il s’assit à califourchon sur la chaise et avançant la mâchoire inférieure, reprit à voix basse : « Il lui arrivait de se promener en tête de l’escadron, et non sur un cheval, mais sur un diable, tout en ruades ; et chevauchant ainsi comme un diable, lui aussi. Le commandant d’escadron s’avançait pour la revue.
« Lieutenant ! disait-il, s’il vous plaît, sans vous ça n’ira pas, faites donc défiler l’escadron au pas de parade. C’est bon », répliquait l’autre, et en se retournant, il criait à ses vieux moustachus…
« Ah ! que le diable m’emporte, ça, c’était le bon temps ! »
Le comte revenant du bain, tout rouge, les cheveux mouillés, entra tout droit au n° 7 où se trouvait déjà le cavalier en robe de chambre qui fumait sa pipe en songeant, avec un plaisir mêlé d’une certaine crainte, à ce bonheur qui lui arrivait de loger dans la même chambre que le célèbre Tourbine. « Eh bien ! se dit-il soudain, et si tout à coup il lui prenait fantaisie de me mettre tout nu, de m’emmener hors de la ville et de me fourrer dans la neige, ou… de m’enduire de goudron, ou tout simplement… non, il ne fera pas cela à un camarade », se rassurait-il.
« Sachka ! donne à manger à Blücher », cria le comte.
Apparut Sachka qui pour se remettre du voyage avait bu un verre d’eau-de-vie et était déjà un peu gris.
« Tu n’as pas pu te retenir. Tu es déjà ivre, canaille ! Donne à manger à Blücher.
– Il ne crèvera pas pour cela. Voyez comme il est gras, rétorqua Sachka en caressant le chien.
– Eh bien, pas de réplique ! Va-t’en lui donner à manger.
– Pour vous, il suffit que le chien soit nourri, mais l’homme, s’il boit un petit verre, alors, vous lui faites des reproches.
– Prends garde ! je vais te flanquer une raclée, cria le comte d’une telle voix que les vitres tremblèrent et que le cavalier éprouva même quelque frayeur.
– Pensez-vous à demander si Sachka a mangé quelque chose aujourd’hui ? Quoi, battez-moi, si un chien vous est plus cher qu’un homme ! » répondit Sachka. Mais aussitôt il reçut un tel coup de poing dans la figure, qu’il tomba, se cogna la tête contre la cloison et, protégeant son nez de la main, fonça dans la porte et tomba sur la banquette du corridor.
« Il m’a cassé les dents, gémissait Sachka en essuyant d’une main son nez ensanglanté, et de l’autre grattant le dos de Blücher qui la léchait. Il m’a cassé les dents, Blüchka, mais quand même il est mon comte et je suis prêt à me jeter au feu pour lui. Voilà, puisqu’il est mon comte, tu comprends, Blüchka ? Tu veux manger, hein ? »
Après être resté allongé un instant, il se leva, donna à manger au chien et, presque dégrisé, alla proposer de manger à son maître.
« Vous m’offenseriez tout simplement, disait timidement le cavalier debout devant le comte, qui, les jambes sur le rebord du paravent, était couché sur son lit. Je suis aussi un vieux militaire, un camarade, puis-je dire. Au lieu d’emprunter à quelqu’autre, je suis prêt avec joie à vous donner deux cents roubles. Je ne les ai pas maintenant, je n’en ai que cent, mais aujourd’hui même je trouverai le reste. Vous m’offenseriez tout simplement, comte.
– Merci, mon vieux, fit le comte, devinant d’un coup quelle sorte de relations devaient s’établir entre eux, et frappant le cavalier sur l’épaule. Merci. Eh bien ! Si c’est ainsi, nous irons aussi au bal. Et pour l’heure, qu’allons-nous faire ? Raconte ce qu’il y a chez vous, dans la ville. Quelles sont les belles ? Qui fait la noce ? Qui joue aux cartes ? »
Le cavalier expliqua qu’une foule de jolies femmes seraient au bal, que l’ispravnik[4] Kolkov, élu récemment, était le plus fieffé des noceurs, mais sans la vraie audace des hussards, qu’il était seulement comme ça, un bon garçon ; que le chœur des tziganes d’Iluchka chantait ici depuis le commencement des élections, que Stiochka y était leur soliste, et qu’aujourd’hui tous iraient chez les tziganes après le bal chez le chef de la noblesse.
« Et on joue beaucoup, ajouta-t-il. Il y a un voyageur, Loukhnov, qui joue argent comptant et Iline qui occupe le n° 8, un cornette des uhlans, qui perd aussi beaucoup. La partie est déjà commencée chez lui ; chaque soir ils jouent. Et quel admirable garçon, comte, que cet Iline. Ah ! il n’est pas avare, il donnerait sa dernière chemise.
– Eh bien, alors, allons chez lui, nous verrons quels sont ces gens-là, dit le comte.
– Allons, allons ! Ils seront très contents. »
Le cornette des uhlans, Iline, venait de s’éveiller. La veille il s’était assis à la table de jeu à huit heures du soir et y était resté quinze heures de suite, jusqu’à onze heures du matin. Il avait perdu beaucoup, mais combien au juste, il ne le savait pas puisqu’il avait entre les mains trois mille roubles à lui et quinze mille de l’État que depuis longtemps il mêlait avec les siens. Et il avait peur de compter, craignant de se convaincre de ce qu’il pressentait, à savoir qu’il manquait déjà beaucoup de l’argent du gouvernement. Il s’endormit jusqu’à midi d’un sommeil lourd, sans rêves, comme en ont seuls les très jeunes gens après de très grosses pertes. Il s’éveilla à six heures du soir, précisément au moment de l’arrivée du comte Tourbine à l’hôtel, et, en apercevant autour de lui sur le parquet les cartes, la craie et les tables maculées au milieu de la chambre, il se rappela avec horreur le jeu de la veille et la dernière carte, le valet, qui lui avait coûté cinq cents roubles. Mais, ne croyant pas encore bien à la réalité, il prit l’argent sous son oreiller et se mit à le compter. Il reconnut quelques billets de banque qui, pendant la partie, avaient passé maintes fois d’une main à l’autre, et se rappela toutes les péripéties du jeu. Des trois mille, il ne restait déjà rien, et deux mille cinq cents de l’argent du Trésor manquaient aussi.
Le uhlan avait joué durant quatre nuits consécutives.
Il arrivait de Moscou où on lui avait confié les fonds de la trésorerie. À K*** le maître de poste l’avait retenu sous prétexte de manque de chevaux, mais en réalité parce qu’il était de connivence avec l’hôtelier pour retenir un jour au moins chaque voyageur. Le uhlan, un garçon très jeune et très gai qui, à Moscou, avait reçu de ses parents trois mille roubles pour son équipement, était heureux de passer quelques jours dans la ville de K*** pendant les élections, espérant s’y bien amuser. Il connaissait un propriétaire rural qui avait de la famille, et se promettait d’aller le voir et de faire la cour à ses filles, quand le cavalier se présenta chez lui pour faire sa connaissance ; et le soir même, sans aucune mauvaise intention, l’entraînait chez ses amis, Loukhnov et d’autres joueurs installés dans la salle commune. Dès lors, le uhlan s’était attelé au jeu et non seulement n’avait pas rendu visite à sa connaissance, le propriétaire, mais cessant de réclamer des chevaux n’était pas sorti de la pièce depuis quatre jours.
Après avoir fait sa toilette et bu du thé, il s’approcha de la fenêtre. Il voulait se promener pour chasser le souvenir obstiné de la partie de cartes. Il mit son manteau et descendit dans la rue. Le soleil était déjà caché derrière les maisons blanches aux toits rouges. Le crépuscule commençait à s’étendre. Il faisait chaud. Dans les rues sales, des flocons de neige fondante tombaient doucement. À l’idée qu’il avait dormi toute cette journée, bientôt achevée, Iline devint tout à coup fort triste.
« Le jour passé ne se retrouve jamais. J’ai perdu ma jeunesse ! » se dit-il spontanément, non parce qu’il pensait avoir le moins du monde perdu sa jeunesse, mais parce que cette phrase lui était venue à l’esprit.
« Que vais-je faire maintenant ? se demanda-t-il. Emprunter à quelqu’un et partir. » Une dame se hâtait sur le trottoir. « En voilà une sotte ! » pensa-t-il sans savoir pourquoi. « Personne à qui emprunter. J’ai perdu ma jeunesse. » Il s’approcha des galeries commerciales. Un marchand en pelisse de renard était debout sur le seuil de sa boutique et appelait les clients. « Si j’avais écarté le huit, j’aurais tout regagné. » Une vieille mendiante geignait en le suivant : « Personne à qui emprunter ! » Un monsieur en pelisse d’ours passa dans une voiture, un sergent de police était là debout : « Que faire d’extraordinaire ? Tirer sur eux ? Non, c’est ennuyeux ! J’ai perdu ma jeunesse. Ah ! que voici de beaux harnais ! Ah, s’asseoir en troïka ! Eh, vous, mes chéris ! Je vais rentrer à l’hôtel. Loukhnov viendra bientôt, nous nous mettrons à jouer. » Il rentra à l’hôtel, compta encore une fois l’argent. Non, la première fois, il ne s’était pas trompé : il manquait toujours deux mille cinq cents roubles de l’argent du Trésor. « Je mettrai vingt-cinq roubles au premier jeu ; au second le double sur sept mises, ensuite sur quinze, sur trente, sur soixante… trois mille. J’achèterai de beaux harnais et je m’en irai. Mais non, le brigand ne me laissera pas ! J’ai perdu ma jeunesse ! » Voilà ce qui se passait dans la tête du uhlan tandis que Loukhnov en personne entrait chez lui.
« Quoi ! Êtes-vous levé depuis longtemps, Mikhaïl Vassiliévitch ? s’enquit Loukhnov en ôtant lentement de son nez sec les lunettes d’or et les essuyant soigneusement avec un mouchoir de soie rouge.
– Non, je viens de me lever. J’ai dormi admirablement.
– Un hussard vient d’arriver. Il s’est arrêté chez Zavalchevski… Vous n’avez pas entendu ?
– Non. Eh bien ! Il n’y a encore personne ?
– Il me semble qu’ils sont chez Priakhine. Ils ne vont pas tarder. »
En effet, bientôt entraient dans la chambre : un officier de la garnison qui accompagnait toujours Loukhnov, un marchand, d’origine grecque, brun, avec un énorme nez aquilin et des yeux noirs, enfoncés, un gros et gras propriétaire rural, un distillateur qui jouait des nuits entières, toujours par cinquante kopecks. Tous avaient hâte de commencer la partie, mais les principaux joueurs n’exprimaient pas ce désir, et Loukhnov surtout parlait très tranquillement des escrocs de Moscou.
« Peut-on s’imaginer, disait-il… Moscou, la principale ville, la capitale ! Et ils se promènent la nuit avec des bâtons à crochets, déguisés en diables, et effrayent la population stupide, et dévalisent les passants. Et que fait la police ? Voilà bien l’étonnant ! »
Le uhlan écouta attentivement cette histoire de brigands, mais à la fin il se leva et ordonna à voix basse d’apporter les cartes.
Le gros propriétaire parla le premier.
« Eh bien ! messieurs, pourquoi perdre un temps précieux ! Les affaires sont les affaires.
– Oui, hier vous en avez gagné assez par cinquante kopecks, alors ça vous plaît, dit le Grec.
– Oui, c’est vrai, il est temps », renchérit l’officier de la garnison.
Iline regarda Loukhnov. Celui-ci, tout en le fixant, continuait tranquillement son histoire de voleurs déguisés en diables armés de griffes.
« Vous tiendrez la banque ? demanda le uhlan.
– N’est-il pas trop tôt ?
– Bielov ! cria le uhlan, rougissant on ne sait pourquoi, apporte-moi à dîner… Je n’ai encore rien pris, messieurs… Apporte du champagne et donne des cartes. »
À ce moment, le comte et Zavalchevski entrèrent dans la chambre. Il se trouvait que Tourbine et Iline étaient dans la même division. Ils célébrèrent aussitôt en trinquant au champagne, et cinq minutes après ils se tutoyaient. Iline semblait plaire beaucoup au comte. Celui-ci ne faisait que lui sourire et raillait sa jeunesse.
« Quel brave uhlan ! s’écria-t-il. Quelle moustache ! Quelle moustache ! »
Chez Iline le duvet de la lèvre était d’un blond presque blanc.
« Quoi ! On dirait que vous vous disposez à jouer, dit le comte. Eh bien ! Je te souhaite de gagner, Iline ! Je pense que tu es un artiste, ajouta-t-il en souriant.
– Oui, voilà, on se prépare, répondit Loukhnov en ouvrant le paquet de cartes. Et vous, comte, ne daignerez-vous pas ?
– Non, aujourd’hui je ne jouerai pas, autrement je vous battrais tous. Moi, quand je m’y mets, toutes les banques sautent ! Je n’ai pas d’argent pour jouer. J’ai perdu tout à un relais près de Volotchok. Là-bas, il y avait une espèce de fantassin, chargé de bagues, un Grec probablement, il m’a mis à sec.
– Es-tu resté longtemps