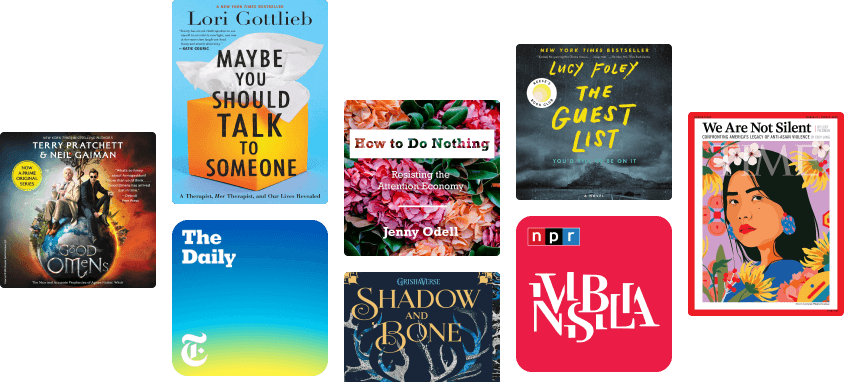Le Hameau près du ciel: Roman
Par Alysa Morgon
()
À propos de ce livre électronique
Aux Collets, la vie n’est que misère et chemin de croix. La neige sévit six mois durant et paralyse ainsi le hameau. Quand elle cesse de tomber, ce sont des pluies torrentielles qui se déversent, emportant tout sur leur passage. Puis soufflent les vents, éreintant les esprits les plus courageux. Les terres sont si maigres que le grain ne peut y germer. Et pourtant cinq familles vivent au gré des saisons et des corvées. Mais elles ne renoncent pas pour autant au bonheur. Petits et grands gardent au fond de leur cœur une part d’innocence, et les plaisirs, si rares soient-ils, prennent une autre importance.
Un roman savoureux, juste et vrai, infiniment touchant, au cœur d’une région âpre et magnifique. Alysa Morgon parvient à mêler tragédie, humour et poésie, pour restituer les sentiments et les émotions de ses personnages face aux éléments les plus hostiles et aux événements les plus terribles. Et puis, soudain, contre toute attente, la vie et l’amour reprennent peu à peu leurs droits…
Une plume poétique qui nous fait dévaler les vallées et suivre le cours des rivières.
EXTRAIT
Il a plu toute la nuit, autant que mon cœur a pleuré, et ce matin, de guerre lasse, tout est gris. L’averse a lavé à grande eau les couleurs de l’été qui s’échappent à petits pas feutrés, barrant l’horizon de brumes longues et lasses, marche de chemineau. Le ciel semble si bas qu’il glisse sur les cœurs un manteau de tristesse, et pose sur le mien une chape de plomb qui sans cesse m’oppresse.
Le cimetière est clôturé par un maigre muret qui s’obstine à vouloir dessiner un drôle de carré. Il est si exigu, si vieillot, si menu, que les tombes s’y mêlent tête-bêche, dos contre dos, dans un méli-mélo qui lui donne ce petit air revêche, désuet, attendrissant, tout mélangé. Les cloches égrènent un glas lourd, lent et ténébreux, tandis que la foule se glisse entre les stèles, en serpents sinueux, une laine au fuseau. Elle suit le corbillard tiré par le mulet, parapluies grand ouverts en ailes de corbeaux. Jour de chagrin
pour accompagner le défunt, le suivre dans ses derniers instants, son ultime chemin. L’assistance se serre en une forme ronde, agglutinée tout autour de la fosse creusée. Le cercueil attend sur le bord, près du tas de terre noire qui semble déjà porter le deuil dans ses entrailles, dans ses pensées.
À PROPOS DE L'AUTEURE
L’amour d’Alysa Morgon pour la nature imprègne chaque page de cette histoire. Et grâce à la poésie qui se dégage de sa plume, l’auteur nous fait cadeau de ce merveilleux sentiment de connaître vraiment quelqu’un qui n’existe pourtant que dans un livre.
Alysa Morgon est née en Provence. Elle y passe toute son enfance et sa jeunesse, entreposant méticuleusement dans sa mémoire des souvenirs qui nourriront son imagination de romancière des années plus tard. À vingt ans, elle change d’accent et s’installe dans les Hautes-Alpes, où elle réside encore aujourd’hui (Gap). Dans chacun de ses romans, les lecteurs retrouvent les couleurs, les senteurs, les coutumes et les traditions provençales, celles d’une Provence qui a malheureusement disparu aujourd’hui.
Précédentes publications aux éditions Lucien Souny : Un Parfum de farigoulette (Poche), Marie des garrigues, L’Épervière en Provence, Un Bouquet de fiançailles, Le Hameau près du ciel (Poche), Un Miroir en bois d'amandier, La Combe noire (Poche), Le Jardin des anges, La dernière transhumance, Les Arbres ont aussi une histoire, La Dentellière des prés.
L'auteure vit à Gap.
En savoir plus sur Alysa Morgon
La Dernière transhumance: Un roman de terroir sur le rêve américain Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationLes Arbres ont aussi leur histoire: Un roman provencal Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationCœurs en miettes: Roman Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluation
Lié à Le Hameau près du ciel
Livres électroniques liés
Contes de Noël par Josette Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationL'Orgue du titan Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationLe château de La Belle-au-bois-dormant Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationContes de Noël par Josette Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationSaint-Laurent mon amour Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationGuy Main-Rouge: Légende du pays de Savoie Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationHypoxies Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationLes Quatre Journées de Jean Gourdon Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationLe Fou de Dieu et le Rêveur d'Etoiles: Roman historique Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationLe monarque Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationDomnitza de Snagov: Les Récits d'Adrien Zograffi - Volume IV Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationUn Amour Vrai Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationLa chasse galerie Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationMadame Chrysanthème: Récit de voyage au Japon Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationLégendes des Alpes vaudoises Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationLa belle étrangère Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationMadame Chrysanthème Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationPâques d'Islande Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationMémoires de Louise Michel écrits par elle-même Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationLe loup sous la blouse Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationL'appel de la Terre Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationBrins de thym et air marin: Recueil de nouvelles Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationRomans dauphinois Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationLes Étés à La Chevinière: Récit de vacances et ode à la nature Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationLes Semeurs de glace Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationFemme à sa fenêtre, lisant... Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationLa Dame pâle Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationLe dernier loup des Millevaches: Polar Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationJane Eyre: Édition Intégrale Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationL'Homme à l'oreille cassée Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluation
Fiction historique pour vous
Quand l'Afrique s'éveille entre le marteau et l'enclume: Roman Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationLe Comte de Monte-Cristo Évaluation : 5 sur 5 étoiles5/5La Légende du Roi Arthur - Version Intégrale: Tomes I, II, III, IV Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationLe Comte de Monte-Cristo - Tome I Évaluation : 5 sur 5 étoiles5/5Les Rougon-Macquart (Série Intégrale): La Collection Intégrale des ROUGON-MACQUART (20 titres) Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationLe Trésor des Cathares: Rennes-Le-Château ou Montségur ? Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationLes Essais (Version Intégrale, Livre 1, 2 et 3) Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationLes Métamorphoses Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationHistoire du Moyen-âge Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationLes Enfants Verts: Par la lauréate du Prix Nobel de Littérature 2018 Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationNouvelles du Sénégal: Récits de voyage Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationLa Dame de pique - Le Nègre de Pierre le Grand Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationLa Sorcière - Version intégrale (Livre I-livre II) Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationLe Prince de Nicolas Machiavel (Analyse de l'œuvre): Comprendre la littérature avec lePetitLittéraire.fr Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationLes Misérables: Roman Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationLe Comte de Monte-Cristo - Tome III Évaluation : 5 sur 5 étoiles5/5Contes merveilleux: La Petite Sirène - La Princesse au petit pois - La Reine des neiges ... Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationMémoires d'un quartier, tome 8: Laura, la suite Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationPères et fils Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationLorenzaccio d'Alfred de Musset (Analyse de l'œuvre): Comprendre la littérature avec lePetitLittéraire.fr Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationHildegarde de Bingen: La puissance et la grâce Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationLa Quincaillerie J.A. Picard & fils: Place des Érables, tome 1 Évaluation : 5 sur 5 étoiles5/5Incarnations Évaluation : 5 sur 5 étoiles5/5Fille de Chouans Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationLe Comte de Monte-Cristo - Tome IV Évaluation : 5 sur 5 étoiles5/5Mémoires d'un quartier, tome 1: Laura Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationLES HÉRITIERS DU FLEUVE, TOME 4: 1931-1939 Évaluation : 5 sur 5 étoiles5/5Un Conte de deux villes Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationLes travailleurs de la mer: Roman Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationSalammbô Évaluation : 4 sur 5 étoiles4/5
Avis sur Le Hameau près du ciel
0 notation0 avis
Aperçu du livre
Le Hameau près du ciel - Alysa Morgon
« Avec les mots on ne se méfie jamais suffisamment… »
Louis-Ferdinand Céline,
Voyage au bout de la nuit.
À Fernand FREYNET
En souvenir de ces journées passées autour du patois, avec mes plus affectueuses pensées gaudemarounes.
À Yves BERGER
En souvenir de son amitié affectueuse, et en témoignage de toute ma reconnaissance.
Il a plu toute la nuit, autant que mon cœur a pleuré, et ce matin, de guerre lasse, tout est gris. L’averse a lavé à grande eau les couleurs de l’été qui s’échappent à petits pas feutrés, barrant l’horizon de brumes longues et lasses, marche de chemineau. Le ciel semble si bas qu’il glisse sur les cœurs un manteau de tristesse, et pose sur le mien une chape de plomb qui sans cesse m’oppresse.
Le cimetière est clôturé par un maigre muret qui s’obstine à vouloir dessiner un drôle de carré. Il est si exigu, si vieillot, si menu, que les tombes s’y mêlent tête-bêche, dos contre dos, dans un méli-mélo qui lui donne ce petit air revêche, désuet, attendrissant, tout mélangé. Les cloches égrènent un glas lourd, lent et ténébreux, tandis que la foule se glisse entre les stèles, en serpents sinueux, une laine au fuseau. Elle suit le corbillard tiré par le mulet, parapluies grand ouverts en ailes de corbeaux. Jour de chagrin pour accompagner le défunt, le suivre dans ses derniers instants, son ultime chemin. L’assistance se serre en une forme ronde, agglutinée tout autour de la fosse creusée. Le cercueil attend sur le bord, près du tas de terre noire qui semble déjà porter le deuil dans ses entrailles, dans ses pensées.
Sans attendre, M. le curé récite ses prières, les femmes lui répondent, pendant que les idées des hommes vagabondent loin de ces funérailles. Les miennes, chagrinées davantage, ne vont guère plus loin que la plaque de cuivre fixée sur le bois clair, en message, et sur laquelle deux noms ont été gravés : Jean Marrou, dit Tancrèbe. Des noms qui me font sourire, parce que ce sont aussi les miens. En effet, je m’appelle Jean Marrou, comme mon pauvre père qu’aujourd’hui on enterre. C’est mon nom officiel, le seul authentique, celui marqué sur le livret de famille, mon identité. Pourtant, il s’agit de celui que j’ai le moins porté, le moins utilisé au cours de toutes mes années. Vrai, personne ne m’a jamais appelé Jean Marrou, si ce n’est à l’armée, lorsque j’ai fait mon service militaire. On me nomme encore Petit Jean, surtout mes frères. Nom trouvé cette fois par ma mère lorsque j’étais enfant, parce que je n’étais pas très fort ni bien grand, et plutôt d’un tempérament souffreteux. En vérité, on m’appelle surtout Jean de Tancrèbe, c’est-à-dire Jean, fils de… C’est le nom le plus usé, celui qu’on m’a attribué toute ma vie, à l’école, entre amis, au pays. En somme, et je le reconnais volontiers, voilà beaucoup de noms pour un seul homme !
Dans ce cimetière, mon père s’en va ce matin vers un autre destin, et m’abandonne au mien attristé. Soudain, peut-être à cause de ce ciel gris, de ces ombres de circonstance, il me plaît d’écouter résonner dans ma tête toute l’histoire et la raison pour laquelle on le surnommait justement Tancrèbe. Il me revient à l’esprit le souvenir d’une nuit de juillet où j’ai tout découvert de son passé, de son existence, et de la fatalité qui s’était invitée le jour de sa naissance…
Je devais avoir une dizaine d’années, et il pleuvait « comme vache qui pisse ! » se serait écrié mon père, Tancrèbe. À ne plus distinguer le sentier, les sommets et les précipices. Quel drôle de temps ! Des éclairs zébraient le ciel tout entier, à ne plus les compter, impressionnants. Malgré tout, envoyé par le village, je montais dans l’alpage, à l’aup’, disait-on dans la vallée, avec Gaston, un garçon de mon âge, pour porter au berger qui passait l’été dans les verts pâturages quelques kilos de sel pour les troupeaux qui vagabondaient plus loin, plus haut, vers les sommets et les cascades. Tout en marchant, je pensais à ceux qui, hier, dans cette montagne retirée, peuplaient quelques hameaux singuliers, oubliés : des terres inhospitalières. De fait, des âmes fortes et résignées restaient là, isolées durant plus de six mois de l’année, et s’obstinaient à vivre dans ces lieux inquiétants qui narguaient tous les vents ; avec des maisons et des champs qui tutoyaient le ciel, défiaient la nature, l’équilibre, et savoir, peut-être l’Éternel !
Dans les minutes qui suivirent, nous arrivâmes au hameau des Collets. D’un pas pressé, nous traversâmes quelques ruines abandonnées, avec leurs pans de murs tout délabrés, poutres tombées, noircies, et le reste parti en fumée depuis nombre d’années.
Gaston, arrêté pour regarder, constata sans un brin de pitié :
— Fallait donc être fou pour rester vivre si près des cimes. Que des sauvages, ces gens-là !
— Peut-être, mais c’est le pays de mon père ! lui répondis-je avec fierté, tandis que la colère me montait au nez pour si peu de respect à l’égard de ces gens, et de leur misère.
Néanmoins la conversation s’arrêta là, parce que la pluie était si forte qu’il nous fallait tenir la tête baissée et regarder où nous mettions nos pieds chaussés de gros souliers ferrés. Nous ruisselions, à ne point avoir envie de causer davantage ni de ralentir notre pas cadencé pour admirer le paysage. Nous marchions donc en silence, dans des prairies inondées, où l’herbe était spongieuse, et parfois nous devions traverser de minuscules lacs où l’eau trompeuse nous arrivait à la cheville. Notre pèlerine, de plus en plus lourde, pesait sur nos maigres épaules, chargées par en dessous d’un gros sac à dos rempli, jusqu’à son col, de provisions, de blocs de sel et de saindoux.
Noël, le vieux berger que nous allions rejoindre, n’aimait pas les étrangers, les trublions. Souvent il lançait des pierres à ceux qui s’aventuraient trop près de son troupeau, de sa maison. Aussi étions-nous inquiets… S’il lui prenait la folie de ne point vouloir nous laisser entrer ?
Non, il nous reconnut aussitôt, car ce n’était pas la première fois que nous venions à Lauzereau. D’ailleurs, il nous accueillit avec le sourire, en nous voyant arriver trempés de la tête aux pieds.
— Avec ça, vous êtes au moins lavés pour une année ! Et c’est gratuit par-dessus le marché !
Peu enclins à plaisanter, parce que nous étions épuisés et gelés, nous avons posé tout de suite nos sacs près du feu, afin d’enlever l’humidité du sel si précieux qu’on nous avait confié, et qui avait été accompagné de mille recommandations. Puis nous nous sommes déshabillés pour sécher nos chemises, nos pantalons, nos gilets et nos chaussettes qui fumèrent volontiers, tandis qu’une odeur singulière se répandait dans la pièce assombrie.
Dans celle voisine, depuis que nous étions entrés, peut-être pour nous saluer, on entendait quelques agneaux bêler, et tinter les sonnailles des vaches qui allaient bientôt vêler.
Noël, d’un mouvement de tête vers le toit, nous montra le fenil.
— Vous allez passer la nuit ici. Avec l’orage, il ne fait pas bon passer au pied des barres.
Certes, l’orage grondait, tapait sur les cimes, faisait des ricochets et de grands signes, mais en bas, au moment de notre départ, il avait été convenu que nous coucherions à Lauzereau pour ne pas risquer une descente dans la nuit, et ce scénario nous avait ravis. Aussi étions-nous étonnés que l’homme, à présent, fasse celui qui invitait.
Pendant que l’on finissait de sécher et de se réchauffer, aussi nus que des vers de terre sous une couverture qui nous piquait sans arrêt les fesses et les mollets, Noël alla faire manger les bestiaux, et on l’entendit leur parler aussitôt. Au village, certains assuraient que les bêtes lui répondaient, aussi écoutions-nous avec fébrilité, afin de connaître la vérité sur ces commérages et ces comportements. Cependant, rien ne devait arriver jusqu’à nous, sauf quelques bêlements supplémentaires.
— Peut-être qu’il les chatouille ? suggéra Gaston.
Ce qui nous fit éclater de rire, à gorge déployée.
Une fois Noël revenu, nous nous étions à moitié rhabillés, malgré nos vêtements qui restaient humides, et que l’on avait enfilés avec difficulté, car nous ne pouvions plus supporter ce gros drap rugueux, moisi, qui nous recouvrait, et qui nous faisait nous gratter. C’était pire qu’une fouettée d’orties. Le berger sortit du jambon, un fromage, et nous, de nos sacs, une grosse miche de pain, ainsi que deux litres de vin envoyés par nos pères.
Comme nous ne parvenions pas à nous réchauffer, pour nous ravigoter, l’homme ne tergiversa pas et nous servit une tasse d’eau chaude dans laquelle il versa une bonne rasade de gnôle et trempa une cuillère de miel. J’hésitais à boire, car c’était la première fois que l’on me servait de l’alcool, et je regardais Gaston, ravi, complice de cet événement dont nous nous vanterions plus tard à l’école.
— Vous êtes presque des hommes ! nous rassura Noël. En plus, y a que moi qui le vois. Profitez-en !
À ces mots, tous deux nous bombâmes le torse, heureux du compliment, et bûmes le breuvage brûlant, rude et fort, d’un seul trait, presque d’une seule gorgée, aussi bien que des hommes ! Cependant, l’instant suivant, nous avons toussé, à nous étouffer, plus rouges que des pivoines !
Très vite, la nuit tomba, et la pluie ne cessa de courir sur le toit, en galop de mulet qui s’emballe. Nous mangions la soupe de bon appétit, lorsque Noël me questionna :
— Tu es le fils de Tancrèbe, n’est-ce pas ? Tancrèbe des Collets !
Et il baissa la main pour certifier que je n’avais pas besoin de lui répondre parce qu’il le savait depuis longtemps.
— De toute façon, il n’y en a jamais eu un autre nulle part !
— Pourquoi il s’appelle Tancrèbe, son père ? demanda Gaston à son tour. Ce n’est pas un saint du calendrier, pavré ?
J’allais rétorquer, mais Noël me coupa la parole.
— Y en a pas beaucoup qui pourraient le conter. Mais moi, je sais toute l’histoire sur le bout des doigts et dans le détail ! Et toi, tu la connais ?
Je fis non avec la tête, car je ne m’étais jamais posé la question. Je n’étais pas curieux de nature. En revanche, Gaston reprit, joyeux :
— Et vous, vous vous appelez Noël, comme le 25 décembre ?
— Tout pareil, puisque c’est ma date de naissance.
— Bè, vous avez de la chance de ne pas être né le 14 juillet, sinon on vous appelait Fête Nationale ! Et là, ç’aurait été pire que Tancrèbe !
Nous avons éclaté de rire tous les trois, à cause de la réflexion de Gaston, bien sûr, mais surtout parce que l’alcool commençait à faire son effet, nous faisant tourner la tête et les idées, à tomber raides sur le plancher !
Plus tard, assis dans le foin, là-haut, sous le toit, Noël nous expliqua toute la vie d’hier aux Collets. J’écoutais, attentif, les mots, les phrases, choisis et récités par le berger, qui me dévoilaient un mystère : la vie de mes grands-parents dans ce triste hameau solitaire.
— Mieux que les Collets, cet endroit aurait dû s’appeler les Terres Maigres…, précisa-t-il, avec dans la voix un accent affligé qui traîna longtemps dans la pièce, à comprendre qu’il connaissait aussi cette vie d’hier oubliée, qu’il l’avait certainement partagée ?
Ensuite, durant des heures, mais en patois cette fois, il a fait vivre mon arrière-grand-père, Silvère, le patriarche des Collets qui ne s’exprimait pas en français ; il a parlé de mon grand-père, Gabin, et bien sûr de mon père, Tancrèbe, entouré de tous les siens, dans cette chaumière des sommets. Ainsi, sans ces révélations inattendues et jusque-là restées secrètes, endormies dans les ruines perdues de ce petit hameau ; sans Noël, qui m’a confié, cette nuit-là, ce long poème, ce chant d’amour à tous les miens ; sans tout cela, aujourd’hui, dans ce cimetière, je ne pourrais les sentir aussi vivants. Tellement vivants qu’il me semble les voir s’animer devant moi maintenant.
1895. Au plus loin du sillon creusé par la rivière depuis la nuit des temps, au fond du fond, au bout du bout, à la fin de tout, la vallée semblait écarter ses bras, supplique agenouillée, pour se jeter au pied des monts déchiquetés, des murs de pierre brute, des glaces éternelles, où les prairies, des tapis de lichen oublié, avaient remplacé les forêts. À cet endroit, restait tout un hameau qui tutoyait les nues, les ailes des oiseaux. Un hameau près du ciel, avec quelques bâtisses aux toits bas, couverts de chaume chevelu, semées en drôle de destin, tel un jet d’osselets sur le dos d’une main. Des fermes, toutes petites, qui se perdaient dans des rochers descendus et roulés depuis nombre d’années, d’orages et de vents, d’avalanches emportées. Des jardins, plus petits qu’un mouchoir, se cachaient dans leurs dos. Des champs, élevés avec patience et rudement conquis, bordés de longs murets, en ourlet de poupée, juste en dix pas comptés, escaladaient encore les versants de l’adret en enjambées d’espoir. Tout était si petit, et néanmoins si grand, si haut, écrit en majuscules au pourtour de l’endroit, que dans sa démesure les hommes vivaient là plus âprement qu’ailleurs, à ne pouvoir l’imaginer, le croire, le penser, parce que cela semblait une chose hors nature. Et pourtant…
Pourtant, à cette heure, aux Collets, l’air devenait plus frais, une aile de velours qui vous fait frissonner. Si frais que ce matin, la maisonnée levée, Silvère se tenait sur le pas de la porte et humait l’air glacé, pétillant, ainsi que le ferait un furet qui lèverait son nez pour détailler, inquiet, les effluves du vent.
— Faut ramasser les truffes, Gabin ! Voilà les couteaux de l’hiver qui s’approchent, les ombres pendolent déjà, comme une langue de loup.
— On y va, père, on y va…, répliqua le fils.
Il le rejoignit tout de même, afin de regarder le ciel, puis cracha par terre et retourna dans la pièce pour terminer sa soupe qui était en train de refroidir.
— De toute façon, ces pauvres patates vont finir par geler sur place si on les laisse plus longtemps macérer dans la glace, souligna-t-il, en même temps qu’il avalait le fond de son assiette et essuyait sa bouche d’un revers de main.
Il se leva, un imperceptible sourire se dessinant sur ses lèvres, parce qu’il pensait à ce père qui lui rappelait sans cesse qu’il n’avait point le droit de décider à sa place, même si l’âge lui donnait déjà des rides au visage et des douleurs au dos.
— Quelle tête d’âne ! souffla-t-il entre ses dents.
Mais ce fut tout. Respectueux, le fils ne lâcha mot davantage. Tels étaient les usages de ces gens.
Il était vrai que Silvère avait trouvé son lot dans ces lieux de douleur, de misère ; qu’il avait confié sa vie et sa sueur à cette maigre terre, aussi estimait-il avoir le droit de commander sous son toit. De surcroît, il utilisait tout le temps le patois, celui du pays, celui de ses pères, en langue mystère et aux mots plus rugueux que ces temps. Dans ces conditions, comment changer ce qui était ancré depuis longtemps ?
D’un pli de satin blanc, la gelée avait jeté sa pelisse d’argent. En sculpteur, en orfèvre, elle avait ciselé les feuilles et les fleurs, brindilles et cailloux, pour en faire aussitôt de drôles de bijoux : des broches, des diamants, toute une rivière à l’instant, dès que le soleil avait posé un pied sur le hameau, sans écraser son dos, parce qu’il avait dans le regard un teint de retenue, si pâle à l’automne venu. Pourtant, en un clin d’œil, tout avait rutilé, prophéties de sorcière, puis s’était volatilisé presque par enchantement, pour finir en rosée familière. Chaque jour, l’orfroi était devenu plus épais, la morsure profonde, un point de rajout sur le napperon de ce monde, et la terre tremblait, durcissait sa croûte et glaçait sa mie, à se fendre d’effroi, se flétrir, se gercer toute nue dans son lit.
Malgré tout, ce matin, tous les habitants se trouvaient rassemblés dans les champs. Ainsi aurait-on pu songer à quelque beau marché, à un très grand festin, si le travail ne leur avait courbé l’échine de façon singulière. Le ciel était si clair que là-haut, en flèches d’arrogance, se découpaient les cimes. En filous, les sommets avaient posé sur eux une mantille blanche, une deuxième peau qui descendait sans bruit pour frôler leurs genoux. En effet, chaque jour, la lumière mutait, se transformait pour devenir plus ocre, mordorée, et les grands sapins noirs, si ombreux, se mêlaient aux mélèzes légers, encore soyeux, dont la fourrure rousse n’allait point tarder à tomber, et à dérouler sur le sol son tapis orangé, emmitouflant