Papers by David Bardey

Consultable sur cairn.fr : https://www.cairn.info/revue-annales-de-bourgogne-2024-1-page-31.htm?c... more Consultable sur cairn.fr : https://www.cairn.info/revue-annales-de-bourgogne-2024-1-page-31.htm?contenu=article
Où le chartrier des ducs de Bourgogne est-il conservé à la fin du xiiie et au début du xive siècle ? Si l’historiographie bourguignonne s’accorde sur une conservation du chartrier à Talant au milieu du xive siècle, la situation est beaucoup plus trouble pour la période antérieure. La documentation diplomatique et comptable, ainsi que plusieurs bilans de transferts d’archives, montrent que les archives des ducs étaient probablement dispersées à l’échelle du duché et conservées dans les différents châteaux ducaux. Les pièces scellées, conservées dans des boîtes et des écrins, circulaient entre les résidences ducales selon les nécessités du gouvernement. Certaines étaient même amenées à quitter le duché pour rejoindre des dépôts ducaux situés hors du duché, notamment à Paris, tandis que d’autres pouvaient sortir définitivement du chartrier ducal pour en intégrer un autre. Clercs et agents du prince administraient et géraient les affaires courantes en prenant appui sur des écrits qu’ils devaient déplacer. Ainsi, c’est l’image d’un chartrier vivant et en mouvement qui s’esquisse.

Au cours des dernières années du XIIIe siècle, un inventaire des archives ducales de Bourgogne es... more Au cours des dernières années du XIIIe siècle, un inventaire des archives ducales de Bourgogne est dressé. Ce document, probablement rédigé sur rouleaux, est connu par l'intermédiaire de copies qui se trouvent dans le cartulaire des ducs. Son élaboration et ces copies s’inscrivent dans un contexte d’évolution des pratiques du gouvernement ducal : l’inventaire répond ainsi à de multiples logiques liées à l’exercice du pouvoir. L’objectif de ma présentation est de montrer que l’inventaire constitue un outil de gestion des archives princières et donc de gouvernement, mais aussi que le classement qu’il décrit participe de la représentation, de l’appropriation et de la structuration de l’espace du duché.
La rédaction de l’inventaire est d’abord une réponse à la nécessité de gérer une masse documentaire qui s’accroît depuis plusieurs décennies, il s’agit aussi de concourir à un effort d’organisation de l’administration du duché. Par ailleurs, la description des pièces contenues dans les archives participe de la redéfinition du pouvoir ducal et des droits dont dispose Robert II après la résolution de la crise successorale qui a suivi la mort de son père, Hugues IV (1218-1272).
En outre, la rédaction et l’organisation interne de l’inventaire font écho au classement et à la conservation des archives à la fin du XIII e siècle. Cet instrument laisse en effet apparaître qu’elles sont structurées en trois grands ensembles : le premier est relatif aux fiefs, le deuxième aux acquêts et dans le troisième sont conservés des actes émis par des rois, des reines et des princes. Si le dernier est organisé en fonction de l’identité des commanditaires, les deux premiers sont divisés en sous-ensembles géographiques. Leur restitution, à partir de représentations cartographiques, permet de saisir un maillage du duché qui est propre à l’archivage. Aussi ce classement permet-il d’esquisser, à diverses échelles, la vision que les ducs pouvaient avoir de leur principauté, tant dans son organisation intérieure que dans son rapport avec d’autres royaumes et principautés d’Occident. Enfin, l’analyse des choix réalisés pour la description des documents permettront d’interroger le statut des archives, leurs usages et la place qu’elles occupent dans l’exercice du pouvoir ducal à la fin du XIII e siècle.

Le Moyen Âge, 2023
Le 26 septembre 1272, le duc Hugues IV de Bourgogne dicte ses dernières volontés et désigne son t... more Le 26 septembre 1272, le duc Hugues IV de Bourgogne dicte ses dernières volontés et désigne son troisième fils, Robert, comme successeur au duché. La mort de ses deux premiers fils, en 1266 et 1267, l’avait mis face à une situation difficile : certaines coutumes bourguignonnes désignaient, selon le principe de la représentation, sa petite-fille Yolande comme héritière de l’honneur ducal. Ne voulant pas se résoudre à ce scénario, Hugues IV choisit d’outrepasser ces usages et désigne le plus âgé de ses fils survivants, Robert, pour lui succéder. À sa mort, en octobre 1272, un conflit juridique opposant le nouveau duc, Robert II, et sa nièce, Yolande, s’est ouvert. Chacune des parties s’est alors défendue en revendiquant les droits qui devaient revenir au primogenitus : ceux du primogenitus mâle survivant et ceux de la fille aînée du primogenitus biologique. En retraçant les préparatifs de cette succession et la résolution du conflit qui a suivi, la présente étude entend saisir les enjeux de la transmission de l’honneur ducal et la place occupée par la primogéniture dans la succession au duché de Bourgogne à la fin du XIIIe siècle.
Article disponible sur cairn : https://www.cairn.info/revue-le-moyen-age-2023-3-page-701.htm

Annales de Bourgogne, 2018
Le principat du duc Robert II de Bourgogne (1272-1306) marque une rupture dans le gouvernement du... more Le principat du duc Robert II de Bourgogne (1272-1306) marque une rupture dans le gouvernement du duché capétien. Les évolutions qui caractérisent l’exercice de son pouvoir sont intimement liées aux relations qui l’unissent aux rois de France contemporains de son règne : Philippe III le Hardi et Philippe IV le Bel. En faisant preuve d’une fidélité à toute épreuve, Robert II se place au plus près de ces rois afin d’affirmer son autorité et de satisfaire ses ambitions. Ce rapprochement est le fait de deux éléments majeurs : la politique matrimoniale entreprise par les ducs de Bourgogne, depuis Hugues IV, et les nombreux services rendus par Robert II aux rois tant dans le domaine militaire que dans le gouvernement royal. Cette proximité participe à l’évolution des pratiques de gouvernement ; en quittant régulièrement ses terres pour le service du roi, Robert II doit déléguer son pouvoir et être capable de faire respecter son autorité malgré ses nombreuses absences. Par ailleurs, ces liens participent à l’évolution de l’exercice de son pouvoir et semblent modifier les pratiques administratives dans le duché comme en témoignent l’évolution de la comptabilité et les carrières de personnages proches du duc.
Conference Presentations by David Bardey
La syntaxe du codex. Une approche théorique à la complexité des manuscrits anciens et médiévaux M... more La syntaxe du codex. Une approche théorique à la complexité des manuscrits anciens et médiévaux Marilena Maniaci (Université de Cassino) Savoirs et savoir-faire administratifs et comptables dans le duché de Bourgogne au XIII e siècle David Bardey (Université de Namur, PraME) La contemplation comme savoir, le savoir comme contemplation : autour des Célestins de France (XIV e-XV e s.

La politique du bâti des ducs de Bourgogne est aujourd’hui bien connue. Certains chantiers, tels ... more La politique du bâti des ducs de Bourgogne est aujourd’hui bien connue. Certains chantiers, tels que celui de la Chartreuse de Champmol ou de l’Hôtel ducal de Dijon, ont fait l’objet de monographies monumentales permettant de saisir le poids de la politique du bâti dans le gouvernement des ducs de Bourgogne durant les derniers siècles du Moyen Âge.
Si cette politique du bâti a fait l’objet de plusieurs études, ses aspects administratifs restent largement méconnus. Les comptabilités ducales offrent pourtant un regard inédit sur la manière dont les chantiers étaient administrés. À travers une étude des pratiques scripturales, l’ambition est de saisir la manière dont les ducs et leurs hommes administraient les chantiers dans le duché. Face à l’« embarras de richesse » des archives bourguignonnes, le propos se cantonnera aux comptes des châtelains dont les séries débutent durant les premières décennies du XIVe siècle. L’ambition est à la fois de saisir les mécanismes de prise de décision et d’application de cette politique du bâti et de dresser un tableau des techniques administratives mises en œuvre par les agents chargés de la gérer. Une attention particulière sera ainsi portée aux acteurs de l’administration et cela à toutes les échelles depuis les clercs et les maîtres qui œuvraient à la Chambre des comptes de Dijon jusqu’aux agents locaux chargés des travaux à l’échelle locale.

Les fonds d'archives privés, tels que nous les connaissons aujourd'hui, sont souvent décontextual... more Les fonds d'archives privés, tels que nous les connaissons aujourd'hui, sont souvent décontextualisés. La réunion de Dijon s'attache, dans le cadre particulièrement riche des deux Bourgogne, à rétablir le lien entre ces archives et les conditions matérielles de leur conservation, de leur préservation, de leur organisation et souvent de leurs réorganisations successives, aux époques médiévale et moderne. Elle ambitionne ainsi de croiser l'histoire des fonds constitués par la noblesse, dont l'intérêt pour l'écrit, inséparable des usages juridiques, fonciers, comptables et généalogiques qui peuvent en être faits, s'affirme dès la seconde moitié du XIIIe siècle, et l'histoire florissante de la résidence aristocratique, à la ville (hôtel) comme à la campagne (château, maison forte). Certains châteaux eurent-ils une vocation de dépôt d'archives ? Des caves inondables aux greniers inflammables, où et comment l'espace castral veillait-il (ou non) à assurer la protection de ces documents, permettait leur consultation et leur copie ? Entre sanctuarisation, soin attentif et négligence, la longue vie matérielle des archives traduit aussi la valeur patrimoniale, historique et symbolique qui leur a été reconnue au fil des siècles. Colloque international organisé par Sarah Fourcade (UPEC),

Il n'est plus question aujourd'hui de penser l'État sans son corollaire de bons et de mauvais cad... more Il n'est plus question aujourd'hui de penser l'État sans son corollaire de bons et de mauvais cadeaux. La question étant de savoir où s'arrête la libéralité et où commence la corruption ». C'est en ces termes qu'Élodie Lecuppre-Desjardin, dans un article de 2018, souligne la place centrale occupée par « l'économie du don » dans les pratiques gouvernementales des sociétés de la fin du Moyen Âge, mais aussi les enjeux et les difficultés que recouvre sa définition. Les occasions de donner et de recevoir étaient effectivement nombreuses dans les sociétés anciennes. Depuis l'ouvrage pionnier de Marcel Mauss, Essai sur le don (1925), les travaux historiques n'ont pas manqué de souligner l'importance et la vigueur de ces pratiques au sein des liens sociaux qui unissaient les individus entre eux ou vis-à-vis d'une autorité, qu'elle soit politique, religieuse, morale, etc. Qu'ils agissent de manière directe, par leurs formes par exemple, ou de manière indirecte, par la communication symbolique qui se déploie au moment de la transaction, les dons sont omniprésents dans les sphères décisionnelles des sociétés médiévales. En outre, les travaux récents, à travers le dépassement de la rupture entre un Moyen Âge dominé par l'économie du don et une modernité marquée par la domination du système numéraire, ont démontré la pertinence des gratifications comme clef de voûte d'un réseau d'obligations réciproques, liant les hommes entre eux dans le cadre d'une « économie de la faveur ». Utiliser ce paradigme anthropologique offre donc un prisme privilégié pour observer ces pratiques mais soulève encore de nombreuses problématiques. Ces thématiques mettent en évidence de multiples questions : comment caractériser ces pratiques et déterminer leur place dans la pensée politique médiévale ? Quels rôles jouaient-elles dans la circulation des richesses et des hommes ? Quelle place tenait cette « économie de la faveur » dans les gouvernements médiévauxecclésiastiques, royaux, princiers, seigneuriaux ou urbainset leur système de représentation ? Au-delà du numéraire, quels étaient les objets qui pouvaient être offerts et dans quelles perspectives ? Comment ces pratiques étaient-elles perçues, appréciées voire condamnées par les contemporains ?
7 e arr. | Salle Marc-Bloch CIHAM | UMR 5648 | Histoire, Archéologie, Littératures des mondes chr... more 7 e arr. | Salle Marc-Bloch CIHAM | UMR 5648 | Histoire, Archéologie, Littératures des mondes chrétiens et musulmans médiévaux CNRS | LYON 2 | EHESS | ENS DE LYON | AVIGNON UNIVERSITÉ | UNIVERSITÉ LYON 3 ED 483 | ED 484 | ED 286 | ED 537 Création : Serge Pinche, CIHAM • Visuel : La Divine Comédie de Dante (BnF, Manuscrits, italien 78, f° 53v°-54r°)
by Giovanni Collamati, Andrea Casalboni, Davide Del Gusto, Francesco Macinanti, Maria Vezzoni, Antonio Antonetti, Fabrizio Pagnoni, Esther Tello Hernández, Alberto Sanna, Nicola Ryssov, Francesco Bozzi, Sean Strong, Marco Fasolio, David Bardey, Antonio Macchione, Gilda de Feo, Ciro Berardinetti, Biagio Nuciforo, Leo Donnarumma, Agostino Paravicini Bagliani, and Tommaso di Carpegna Falconieri Apprendistato dello Storico III (2019). Dialettiche del Potere: rivendicazione, usurpazione, giustificazione, 30-31 Maggio 2019, Università degli studi di Roma - La Sapienza, 2019
Apprendistato dello Storico III (2019). Dialettiche del Potere: rivendicazione, usurpazione, gius... more Apprendistato dello Storico III (2019). Dialettiche del Potere: rivendicazione, usurpazione, giustificazione, 30-31 Maggio 2019, Università degli studi di Roma - La Sapienza, 2019.
Programma delle giornate, completo di orari e titoli delle sessioni e delle relazioni.

by Giovanni Collamati, Francesco Macinanti, Francesco Massetti, Maria Vezzoni, Davide Esposito, Antonio Antonetti, Fabrizio Pagnoni, Esther Tello Hernández, Francesco Bozzi, Stefano Bernardinello, Alberto Sanna, Nicola Ryssov, Sean Strong, David Bardey, Antonio Macchione, Ciro Berardinetti, Biagio Nuciforo, Leo Donnarumma, Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña, Tommaso di Carpegna Falconieri, Federico Del Tredici, Eleonora Plebani, Gaetano Lettieri, Giovanni Contel, Andrea Casalboni, Davide Del Gusto, and Luigi Russo Apprendistato dello Storico III (2019). Dialettiche del Potere: rivendicazione, usurpazione, giustificazione, 30-31 Maggio 2019, Università degli studi di Roma - La Sapienza, 2019
Il potere è stato spesso fine e mezzo dell'agire dell'uomo nel corso dei secoli: la sua ricerca e... more Il potere è stato spesso fine e mezzo dell'agire dell'uomo nel corso dei secoli: la sua ricerca e il suo mantenimento hanno mosso da sempre gli intimi ingranaggi della Storia, dai più ampi contesti europei alle più ridotte esperienze locali. Ad oggi questa sua natura capillare ci permette di elevarlo a privilegiato punto di osservazione delle vicende umane. Si tratta dunque di un argomento trasversale che consente di mettere in relazione studi apparentemente distanti, ma intimamente interconnessi, come quelli proposti in questo incontro. Anche quest’anno l’Apprendistato dello Storico persegue infatti lo scopo per cui è stato ideato: mettere a confronto le ricerche di giovani studiosi provenienti da tutta Europa, sotto l’occhio attento di esperti medievisti di alto calibro.
Société pour l'histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et ro... more Société pour l'histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands Journée d'études d'histoire du droit et des institutions Dijon, 14 novembre 2018 (Faculté de droit, 3 e étage, salle 319 Georges-Chevrier) 9 h 30. -Laura VIAUT (U. Limoges), Des « orfèvres du droit »… Les professionnels de l'écrit et leur usage des notes tironiennes d'après les manuscrits juridiques carolingiens.
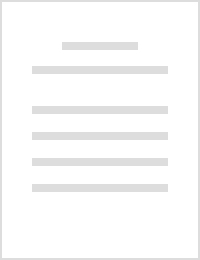
Le principat de Robert II de Bourgogne (1272-1306) marque une rupture dans le gouvernement du duc... more Le principat de Robert II de Bourgogne (1272-1306) marque une rupture dans le gouvernement du duché capétien. Ces évolutions sont intimement liées aux relations qui unissent ce personnage aux rois contemporains de son principat : Philippe III le Hardi et Philippe IV le Bel. Ce rapprochement est dû à deux éléments majeurs : la politique matrimoniale initiée par les ducs depuis Hugues IV et les nombreux services rendus par Robert II aux rois dans le domaine militaire et dans le gouvernement royal.
Ces importants services sont au coeur de leurs relations. Ils permettent d’offrir un regard sur la place qu’occupe le duc dans le gouvernement royal, notamment dans le domaine de l’administration, de la diplomatie ou encore dans les affaires militaires. Plus généralement, cet exemple donne un nouveau point de vue relatif au gouvernement royal et sur les relations entre les rois et l’aristocratie à la fin du XIIIe siècle.
Uploads
Papers by David Bardey
Où le chartrier des ducs de Bourgogne est-il conservé à la fin du xiiie et au début du xive siècle ? Si l’historiographie bourguignonne s’accorde sur une conservation du chartrier à Talant au milieu du xive siècle, la situation est beaucoup plus trouble pour la période antérieure. La documentation diplomatique et comptable, ainsi que plusieurs bilans de transferts d’archives, montrent que les archives des ducs étaient probablement dispersées à l’échelle du duché et conservées dans les différents châteaux ducaux. Les pièces scellées, conservées dans des boîtes et des écrins, circulaient entre les résidences ducales selon les nécessités du gouvernement. Certaines étaient même amenées à quitter le duché pour rejoindre des dépôts ducaux situés hors du duché, notamment à Paris, tandis que d’autres pouvaient sortir définitivement du chartrier ducal pour en intégrer un autre. Clercs et agents du prince administraient et géraient les affaires courantes en prenant appui sur des écrits qu’ils devaient déplacer. Ainsi, c’est l’image d’un chartrier vivant et en mouvement qui s’esquisse.
La rédaction de l’inventaire est d’abord une réponse à la nécessité de gérer une masse documentaire qui s’accroît depuis plusieurs décennies, il s’agit aussi de concourir à un effort d’organisation de l’administration du duché. Par ailleurs, la description des pièces contenues dans les archives participe de la redéfinition du pouvoir ducal et des droits dont dispose Robert II après la résolution de la crise successorale qui a suivi la mort de son père, Hugues IV (1218-1272).
En outre, la rédaction et l’organisation interne de l’inventaire font écho au classement et à la conservation des archives à la fin du XIII e siècle. Cet instrument laisse en effet apparaître qu’elles sont structurées en trois grands ensembles : le premier est relatif aux fiefs, le deuxième aux acquêts et dans le troisième sont conservés des actes émis par des rois, des reines et des princes. Si le dernier est organisé en fonction de l’identité des commanditaires, les deux premiers sont divisés en sous-ensembles géographiques. Leur restitution, à partir de représentations cartographiques, permet de saisir un maillage du duché qui est propre à l’archivage. Aussi ce classement permet-il d’esquisser, à diverses échelles, la vision que les ducs pouvaient avoir de leur principauté, tant dans son organisation intérieure que dans son rapport avec d’autres royaumes et principautés d’Occident. Enfin, l’analyse des choix réalisés pour la description des documents permettront d’interroger le statut des archives, leurs usages et la place qu’elles occupent dans l’exercice du pouvoir ducal à la fin du XIII e siècle.
Article disponible sur cairn : https://www.cairn.info/revue-le-moyen-age-2023-3-page-701.htm
Conference Presentations by David Bardey
Si cette politique du bâti a fait l’objet de plusieurs études, ses aspects administratifs restent largement méconnus. Les comptabilités ducales offrent pourtant un regard inédit sur la manière dont les chantiers étaient administrés. À travers une étude des pratiques scripturales, l’ambition est de saisir la manière dont les ducs et leurs hommes administraient les chantiers dans le duché. Face à l’« embarras de richesse » des archives bourguignonnes, le propos se cantonnera aux comptes des châtelains dont les séries débutent durant les premières décennies du XIVe siècle. L’ambition est à la fois de saisir les mécanismes de prise de décision et d’application de cette politique du bâti et de dresser un tableau des techniques administratives mises en œuvre par les agents chargés de la gérer. Une attention particulière sera ainsi portée aux acteurs de l’administration et cela à toutes les échelles depuis les clercs et les maîtres qui œuvraient à la Chambre des comptes de Dijon jusqu’aux agents locaux chargés des travaux à l’échelle locale.
Programma delle giornate, completo di orari e titoli delle sessioni e delle relazioni.
Ces importants services sont au coeur de leurs relations. Ils permettent d’offrir un regard sur la place qu’occupe le duc dans le gouvernement royal, notamment dans le domaine de l’administration, de la diplomatie ou encore dans les affaires militaires. Plus généralement, cet exemple donne un nouveau point de vue relatif au gouvernement royal et sur les relations entre les rois et l’aristocratie à la fin du XIIIe siècle.
Où le chartrier des ducs de Bourgogne est-il conservé à la fin du xiiie et au début du xive siècle ? Si l’historiographie bourguignonne s’accorde sur une conservation du chartrier à Talant au milieu du xive siècle, la situation est beaucoup plus trouble pour la période antérieure. La documentation diplomatique et comptable, ainsi que plusieurs bilans de transferts d’archives, montrent que les archives des ducs étaient probablement dispersées à l’échelle du duché et conservées dans les différents châteaux ducaux. Les pièces scellées, conservées dans des boîtes et des écrins, circulaient entre les résidences ducales selon les nécessités du gouvernement. Certaines étaient même amenées à quitter le duché pour rejoindre des dépôts ducaux situés hors du duché, notamment à Paris, tandis que d’autres pouvaient sortir définitivement du chartrier ducal pour en intégrer un autre. Clercs et agents du prince administraient et géraient les affaires courantes en prenant appui sur des écrits qu’ils devaient déplacer. Ainsi, c’est l’image d’un chartrier vivant et en mouvement qui s’esquisse.
La rédaction de l’inventaire est d’abord une réponse à la nécessité de gérer une masse documentaire qui s’accroît depuis plusieurs décennies, il s’agit aussi de concourir à un effort d’organisation de l’administration du duché. Par ailleurs, la description des pièces contenues dans les archives participe de la redéfinition du pouvoir ducal et des droits dont dispose Robert II après la résolution de la crise successorale qui a suivi la mort de son père, Hugues IV (1218-1272).
En outre, la rédaction et l’organisation interne de l’inventaire font écho au classement et à la conservation des archives à la fin du XIII e siècle. Cet instrument laisse en effet apparaître qu’elles sont structurées en trois grands ensembles : le premier est relatif aux fiefs, le deuxième aux acquêts et dans le troisième sont conservés des actes émis par des rois, des reines et des princes. Si le dernier est organisé en fonction de l’identité des commanditaires, les deux premiers sont divisés en sous-ensembles géographiques. Leur restitution, à partir de représentations cartographiques, permet de saisir un maillage du duché qui est propre à l’archivage. Aussi ce classement permet-il d’esquisser, à diverses échelles, la vision que les ducs pouvaient avoir de leur principauté, tant dans son organisation intérieure que dans son rapport avec d’autres royaumes et principautés d’Occident. Enfin, l’analyse des choix réalisés pour la description des documents permettront d’interroger le statut des archives, leurs usages et la place qu’elles occupent dans l’exercice du pouvoir ducal à la fin du XIII e siècle.
Article disponible sur cairn : https://www.cairn.info/revue-le-moyen-age-2023-3-page-701.htm
Si cette politique du bâti a fait l’objet de plusieurs études, ses aspects administratifs restent largement méconnus. Les comptabilités ducales offrent pourtant un regard inédit sur la manière dont les chantiers étaient administrés. À travers une étude des pratiques scripturales, l’ambition est de saisir la manière dont les ducs et leurs hommes administraient les chantiers dans le duché. Face à l’« embarras de richesse » des archives bourguignonnes, le propos se cantonnera aux comptes des châtelains dont les séries débutent durant les premières décennies du XIVe siècle. L’ambition est à la fois de saisir les mécanismes de prise de décision et d’application de cette politique du bâti et de dresser un tableau des techniques administratives mises en œuvre par les agents chargés de la gérer. Une attention particulière sera ainsi portée aux acteurs de l’administration et cela à toutes les échelles depuis les clercs et les maîtres qui œuvraient à la Chambre des comptes de Dijon jusqu’aux agents locaux chargés des travaux à l’échelle locale.
Programma delle giornate, completo di orari e titoli delle sessioni e delle relazioni.
Ces importants services sont au coeur de leurs relations. Ils permettent d’offrir un regard sur la place qu’occupe le duc dans le gouvernement royal, notamment dans le domaine de l’administration, de la diplomatie ou encore dans les affaires militaires. Plus généralement, cet exemple donne un nouveau point de vue relatif au gouvernement royal et sur les relations entre les rois et l’aristocratie à la fin du XIIIe siècle.
La plupart des études portant sur les ducs de Bourgogne ont largement délaissé les Capétiens. L'objectif est d'envisager le gouvernement des quatre derniers ducs de cette dynastie - depuis Robert II (1272-1306) jusqu'à Philippe de Rouvres (1349-1361) - à partir de l'évolution des pratiques documentaires. En dressant un panorama des sources conservées à Dijon, notamment aux Archives Départementales de la Côte-d'Or, il s'agira de saisir les changements et les influences que connaissent les pratiques de gouvernement dans le champ de l'administration, de la comptabilité ou encore des archives.